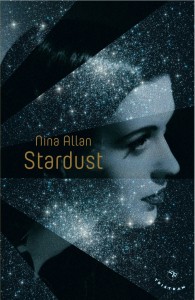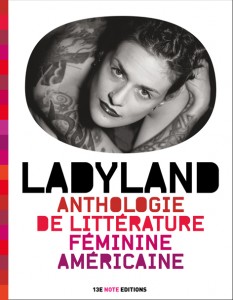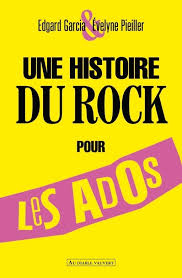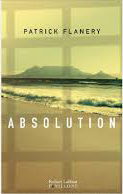Vous affichez actuellement la catégorie : Littérature générale
Trois voix sismiques et sensuelles d’Amérique du Sud ; ces livres sont parus cet hiver et au printemps,

 glissez-les dans votre valise pour l’été.
glissez-les dans votre valise pour l’été.
« Les Bâtardes », d’Arelis Uribe, traduit de l’espagnol par Marianne Million (Quidam Éditeur, 106 p.).
« Les Vilaines », de Camila Sosa Villada, traduit de l’espagnol par Laura Alcoba (Métailié, 204 p.).
« Les Aventures de China Iron », de Gabriela Cabezon Camara, traduit de l’espagnol par Guillaume Contré (Éditions de l’Ogre, 244 p.).
 Quel est le point commun entre Lewis Carroll, Flaubert, Kafka, Barthes, Beckett, l’acteur Daniel Radcliffe et Laure Limongi ? L’AVF, l’algie vasculaire de la face, une migraine épouvantable, provoquant une des douleurs les plus intenses enregistrées, d’où son surnom « la migraine du suicide », et qui touche trois personnes pour mille. « Ça commence comme un orage », « c’est comme un pic à glace enfoncé derrière l’œil », « impossible de s’y habituer, jamais », écrit Laure Limongi dans « Anomalie des zones profondes du cerveau ». Pas question de s’enfermer dans le pathos pour cette guerrière – elle a travaillé, une bouteille d’oxygène de 6 kilos en bandoulière en cas de crise pendant des années –, mais de dévider sa pelote de haine et de digresser du côté de la vie, des écrivains, des films, des séries télé… Alternant des récits courts, voire des fragments, elle « se cartographie comme un continent », s’interroge sur une phrase de Roland Barthes, « mais peut-être que la migraine est une perversion ? » et ne manque pas d’humour à propos Jules César, « le plus ancien migraineux connu. La migraine n’empêche donc pas de conquérir la Gaule. » Mais elle empoigne aussi les laboratoires qui préfèrent faire avaler de l’Imiject, hors prix, et s’abstiennent de développer sérieusement un dérivé du LSD, lequel à doses réduites, a fait des miracles. C’est l’automne, avant de vous jeter sur les champignons, dévorez les miscellanées indociles et pleines d’esprit de Laure Limongi.
Quel est le point commun entre Lewis Carroll, Flaubert, Kafka, Barthes, Beckett, l’acteur Daniel Radcliffe et Laure Limongi ? L’AVF, l’algie vasculaire de la face, une migraine épouvantable, provoquant une des douleurs les plus intenses enregistrées, d’où son surnom « la migraine du suicide », et qui touche trois personnes pour mille. « Ça commence comme un orage », « c’est comme un pic à glace enfoncé derrière l’œil », « impossible de s’y habituer, jamais », écrit Laure Limongi dans « Anomalie des zones profondes du cerveau ». Pas question de s’enfermer dans le pathos pour cette guerrière – elle a travaillé, une bouteille d’oxygène de 6 kilos en bandoulière en cas de crise pendant des années –, mais de dévider sa pelote de haine et de digresser du côté de la vie, des écrivains, des films, des séries télé… Alternant des récits courts, voire des fragments, elle « se cartographie comme un continent », s’interroge sur une phrase de Roland Barthes, « mais peut-être que la migraine est une perversion ? » et ne manque pas d’humour à propos Jules César, « le plus ancien migraineux connu. La migraine n’empêche donc pas de conquérir la Gaule. » Mais elle empoigne aussi les laboratoires qui préfèrent faire avaler de l’Imiject, hors prix, et s’abstiennent de développer sérieusement un dérivé du LSD, lequel à doses réduites, a fait des miracles. C’est l’automne, avant de vous jeter sur les champignons, dévorez les miscellanées indociles et pleines d’esprit de Laure Limongi.
Sandrine Mariette
« Anomalie des zones profondes du cerveau », de Laure Limongi (Grasset, 205 p.).
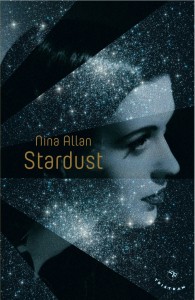 Nina Allan nous avait étonné, puis fortement conquis avec
Nina Allan nous avait étonné, puis fortement conquis avec
« Complication », un premier recueil, couronné du Grand Prix de l’Imaginaire 2014, où surnaturel et onirisme cohabitaient si bien, qu’on se mit à croire possible le voyage dans le temps. En ce début d’année, c’est avec « Stardust », un poème et six nouvelles autonomes hantées par une légendaire Ruby Castle, actrice fictive des années 30, que l’auteure britannique . Elle fascine Michael, 13 ans, prodige des échecs dans « Face B », avant d’apparaître en chair et en os, comme cible d’un lanceur de couteaux, dans un cirque en proie à une frayeur croissante depuis l’arrivée d’une « fillette ou d’un monstre » qui fait très froid dans le dos (« Le Ver du Lammas »). Mais, c’est en entrebâillant « La Porte de l’avenir », Allemagne 1938, que l’on est littéralement happé. Dans une fête foraine, où se tient la coulisse de nos imaginaires, Claudine, 8 ans, insiste auprès du meilleur ami de son père pour entrer dans le Labyrinthe aux miroirs – conçus par le grand-père de Ruby Castle. Dans la vapeur des gaufres, Andrew cède. Elle ne ressortira jamais de ce palais des glaces – créé par le grand-père de Ruby – comme « si elle avait franchi quelque porte invisible », où barbelés, cris, chiens sont maintenant l’avenir de Claudia : le camp de concentration de Nordhausen-Dora (1943)… Nina Allan tisse des structures coulissantes, où éclaircissements furtifs et nouveaux mystères – toutes les facettes de ce « Ruby Cube » – s’épaississent au fil d’une lecture au charme sans répit. Déployant une ode au futur antérieur qui se prolonge bien après que le livre soit fermé.
Sandrine Mariette
« Stardust », de Nina Allan, traduit de l’anglais par Bernard Sigaud (Tristram, 357 p.).
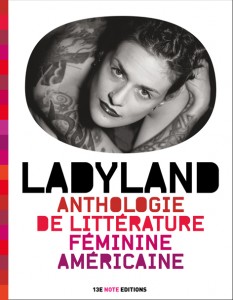
Ladyland
C’est l’expérience littéraire du moment, que nous offrent ces vingt-cinq auteures, pour la plupart inconnues en France, et réunies dans « Ladyland, une anthologie de la littérature féminine américaine ». Description.
Les ladylanders. De 30 à 70 ans, cataloguées écrivaines subversives, féministes post-porn, ou encore estampillées « cult, transgressive, edgy », la plupart de ces ladylanders ont emboîté le pas à Bukowski, Selby, Kerouac… Expertes dans l’art de l’extrême, ces nouvellistes pur-sang, entre fiction et autofiction, elles racontent leurs expériences de gogo-danceuses, de strip-teaseuses, de prostituées… en toute assurance, congédiant la poisse des stéréotypes, avec une ironie qui ne minimisent jamais les fêlures.
Le pitch. Exemptes du poids de l’autocensure, adeptes du rush narratif, les ladylanders ne donnent pas dans la quincaillerie sentimentale, expédiant dans nos habitudes de lecture, persillées de convention, une gerbe de mots implacables : « J’ai toujours su que ça arriverait. Toutes les femmes savent dans leur chair qu’elles peuvent être violées d’un instant à l’autre. Eh bien, ça m’était arrivé. » (« Berceuse pour une pute », de Gina Frangello). Et, on passe à autre chose.
L’expérience. A mi-chemin entre exhibition et inhibition, de deux ados qui jouent, au début, à faire des passes pour de la dope, à une fille qui « suce une bite » pour pouvoir régler le bus qui l’emportera chez sa mère mourante, leur traversée en zone d’inconfort offre une vue imprenable sur le monde underground. Mais, à force de gratter leur odyssée jusqu’à l’esquille, ces « dirty girls » en rapportent une écriture de distanciation irremplaçable, moderne et lumineuse, un bouquet de vie. « Ladyland » est une aventure littéraire unique.
Sandrine Mariette
« Ladyland, une anthologie de la littérature féminine américaine » (13e Note Editions, 493 p.).
Merci à 13 e Note pour ce très beau travail.
« Bring the Noise », de Simon Reynolds (Au diable Vauvert). Panorama complet de vingt-cinq ans de rock et de hip-hop, « Bring the Noise » rassemble interviews, chroniques, reportages, mais aussi des essais argumentés sur les interactions entre la musique blanche et noire ou encore sur les croisements entre les genres… Des Smiths à Public Enemy, en passant par PJ Harvey, du grunge au grime, l’auteur, célèbre rock critic anglais, propose même de livrer un nouvel avis sur certains papiers. Encyclopédique.

The brothers Sisters
C’est avec son deuxième roman « Les Frères Sisters », finaliste pour le distingué Man Booker Prize 2011, que Patrick deWitt, s’est fait un sacré nom dans les lettres anglo-américaines. L’écrivain, qui vit en Oregon, nous invite à partager la route de deux tueurs à gages légendaires, Eli et Charlie Sisters, chargés d’éliminer l’énigmatique Warm dans un Far West sans loi ni règles (1851). Et il faut bien avouer qu’il y a rarement eu un tandem de psychopathes aussi engageants que les Sisters. Déjà, s’appeler les frères Sisters (sœurs) relève du sombrement drôle. Mais deWitt réussit un coup de génie en offrant au lecteur les pensées intimes d’Eli, en l’enfermant dans sa tête, celle d’un narrateur anxieux et dangereux criminel, qui s’interroge au fil des rivières et des pages sur son mode de vie trop violent, son désir d’aimer une femme digne de confiance et, plus grave, sur l’admiration si profonde qu’il éprouve pour son frère qu’elle en devient gênante. Car, Charlie, lui, est un tueur né, vulgaire, impétueux, n’éprouvant aucun scrupule à descendre un gosse. Et lorsque les deux se querellent, les dialogues dépouillés nous propulsent sur des territoires sauvages, et nous lient à la noirceur dense et comique des personnages. Les prospecteurs qui, à force de cupidité et d’infortune, prennent la terre pour du café et s’effondrent fous, les trappeurs poilus et crasses, frustrés de ne pas voir eu la peau d’une ourse – leur apparition déclenche illico un bon fou rire –, se vengent à tout va et, enfin, le fameux Warm, humain, trop humain… Ce western psychologique procure un sentiment permanent d’excitation et de découverte – c’est une tuerie –, en même temps qu’il crée un certain inconfort – la crasse saigne à l’Ouest. Une pépite qui collerait parfaitement à l’objectif des frères Coen. Remarquable.
Sandrine Mariette
« Les Frères Sisters », de Patrick deWitt, traduit de l’américain par Emmanuelle et Philippe Aronson (Actes Sud, 358 p.).
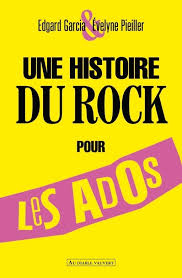
*******
Comment ne pas ciller sur la couverture alléchante de cette « Histoire du rock » ! De ce clin d’œil au vinyle « Never Mind the Bollocks », des Sex Pistols, dessiné par le célèbre Jamie Reid, on en déduit aussitôt et, à raison, un désordre savamment pensé, avant d’apprendre qu’il tire ses influences graphiques des affiches situationnistes, qu’il va devenir le « porte-voix des opprimés », des mal-lotis, des punks, dans une Grande-Bretagne en crise. Et oui, le rock et ses variantes s’inscrivent dans une aventure sociale, économique et politique, dixit cet opus court, mais impressionnant. Des secousses sonores de la contre-culture dans les années 60 aux dépressions mondiales sous électro du nouveau millénaire, des bikers rebelles d’« Easy Rider », aux désenchantés nightclubbers de « 24 Hour Party People », la musique se rebelle contre le libéralisme, la « peopolisation »… et se réinvente à coups de free samples et de paroles clandestines. Une plongée érudite et bluffante dans la planète rock qui va séduire plus d’un teenager !
Sandrine Mariette
« Une histoire du rock pour les ados », d’Edgar Garcia et Evelyne Pieiller (Au Diable Vauvert).

****
La cinquantaine toute neuve, le visage confiant, la voix lumineuse… difficile d’imaginer, en rencontrant Yôko Ogawa, qu’elle est une des romancières les plus troublantes des lettres japonaises. Est-ce parce qu’elle « n’éprouve aucune répulsion à l’égard de ce qui est obscur » que l’étrange personnage de son nouvel opus, « Le Petit Joueur d’échecs », nous bouleverse tant ?
ELLE. Si votre personnage, Little Alekhine, n’était pas né les lèvres scellées, serait-il devenu un virtuose aux échecs ?
YOKO OGAWA. Lorsque Little Alekhine rencontre son maître d’échecs, il a 7 ans. Marqué par des cicatrices sur la bouche, moqué, battu par ses camardes de classe, il est seul, enfermé dans sa tête. Très vite, les échecs lui permettent de s’exprimer de plus en plus fort, de communiquer d’une façon profonde, de se heurter à autrui sans aucune parole.
ELLE. Le silence est-il plus fort que les mots ?
Y.O. Ceux qui ont une bouche, quand ils l’ouvrent, ils ne parlent que d’eux-mêmes. Aux échecs, il n’existe pas de mots plus convaincants, plus parlants que le déplacement des pions, c’est comme une symphonie, une poésie… Sans parler fort, les gens peuvent se parler, s’aimer, se battre. Ils communiquent cœur à cœur dans le silence. En écrivant, inconsciemment, je retrouvais ce thème, la force expressive du silence qui instille mon œuvre.
ELLE. Pour intensifier cet océan bouillonnant de silence, vous rendez Little Alekhine presque invisible ?
Y.O. [Rires.] En écrivant, son corps rapetissait tellement, que Little Alekhine s’est retrouvé sous la table et l’échiquier s’est déplacé dans sa tête. Mais j’aime cette idée obscure de petitesse que j’ai introduite dans « La Marche de Mina », et qui éclate dans « Le Tambour », de Gunther Grass. Son Oscar, comme mon Little Alekhine, arrivent au monde de manière très douloureuse, et ils décident de ne plus grandir tant est fort, le mépris pour l’hypocrisie, la médiocrité… qu’ils éprouvent dans la société des adultes.
Interview de Sandrine Mariette
« Le Petit Joueur d’échecs », de Yôko Ogawa, traduit du japonais par Martin Vergne (Actes Sud, 332 p.).
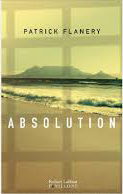
****
Ce n’est pas un hasard s’il revient à Sam Leroux, universitaire new-yorkais, d’écrire la biographie de Clare Wald, géante des lettres sud-africaines, blanche et progressiste depuis toujours. Dès leur premier entretien, dans son bunker de luxe ultra-sécurisé du Cap, Clare Wald taquine ouvertement Sam, « Je n’aime pas votre allure », « J’espère que vous ne pensez pas que nous allons devenir amis », elle feint de ne pas le reconnaître, et refuse catégoriquement d’évoquer sa fille Laura, engagée dans la lutte armée contre l’apartheid, dont elle est sans nouvelles depuis 1989. Mais, à laquelle, elle adresse des lettres imaginaires bouleversantes et note à propos de Sam : « Le trouver, soudain face à moi, c’était comme d’être confrontée à mon assassin. » Sam est-il juste un passionné de l’œuvre de Clare Wald ? Quant à elle, comment a-t-elle pu écrire sous les conditions répressives de l’ancien gouvernement, sous la censure, sans risquer sa vie ou celle de sa famille, alors que tant d’autres ont été persécutés ou se sont exilés ? Sous couvert d’une bio, Patrick Flanery convoque toute la complexité de l’histoire de l’Afrique du Sud avant et après l’apartheid. Construit comme une boule à miroir, « Absolution » réfléchit les différentes versions (le récit de Sam, les fictions de Clare, les carnets de Laura…) d’événements identiques, créant ainsi une soif inextinguible de vérité chez le lecteur, pris dans une atmosphère suspicieuse qui oscille entre tension dramatique et thriller. Virtuose !
Sandrine Mariette
« Absolution », de Patrick Flanery, traduit de l’anglais par Michel Marny (Robert Laffont, 451 p.).
Remarqué grâce à son roman « A marée basse », Jim Lynch confirme son originalité avec « A vol d’oiseau ». Honoré par plusieurs prix de journalisme, traduit dans neuf langues, Jim Lynch, est aussi reporter pour « l’Oregonian » et vit dans l’Etat du Washington. Son nouvel opus, « A vol d’oiseau », où il livre les dérives et les angoisses de notre société, est de de haut vol. Lire la suite…

 glissez-les dans votre valise pour l’été.
glissez-les dans votre valise pour l’été.