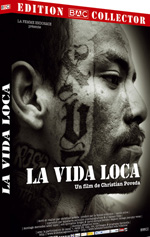Analyse punchy du très beau film-DVD « La Vida Loca »
Le triomphe du Mal
« La Vida Loca », le film sur les gangs de San Salvador de Christian Poveda est sorti en DVD. Une œuvre de chagrin et de pitié où la tendresse lutte désespérément contre le Mal qui prédomine, avec dans son cortège funèbre, sa violence infernale. Au bout du sinistre convoi, un réalisateur assassiné. AnalyseIl s’appelait Christian Poveda, il était né le 12 janvier 1955 en Algérie, fils de réfugiés Républicains de la guerre civile espagnole. Il a été assassiné dans la nuit du 2 au 3 septembre 2009 au Salvador. Journaliste, photographe, spécialiste de l’Amérique latine pour « Le Monde » et « El Pais », il était parti au Salvador au début des années 1980, pour le « Times », puis « Paris Match ». Pénétrant dans la guérilla salvadorienne, il en avait rapporté une série de « Portraits de guérilleros ». Installé définitivement au Salvador, il était devenu réalisateur, signant plusieurs documentaires. En 2007, il avait entrepris un film sur l’affrontement entre les gangs, filmant des membres de la Mara 18 de la Campanera, en périphérie de San Salvador. Christian Poveda venait de terminer son film lorsqu’il a été retrouvé dans une voiture, assassiné de 4 balles dans la tête.
Origines
Qui sont les Maras ? Diminutif du terme marabuntas, fourmis carnivores d’Amérique Centrale, ces gangs sont nés dans le ghetto latino de Los Angeles. Ses membres sont des immigrés clandestins venus du Honduras, du Panama, du Costa Rica, du Guatemala et du Nicaragua, des enfants et adolescents, mais aussi d’ex-paramilitaires et autres tortionnaires ayant fui la guerre civile qui ravagea le Salvador dès 1982. Se mêlant aux traditionnels gangsters chicanos, ces nouveaux gangs, dont les membres sont tatoués de la tête aux pieds, sont organisés en pandillas (bandes) et cliquas (cliques) et se livrent à des activités criminelles, principalement autour du trafic de stupéfiants, tout en menant entre eux une guerre permanente. Ils vont très vite peupler les prisons nord-américaines, y asseoir leur suprématie, via leur marque de fabrique, une violence aveugle et absolue. En 1996, des modifications législatives permettent aux Etats-Unis de se débarrasser de plus de 100 000 détenus et immigrés clandestins, en les renvoyant dans leurs pays d’origine. Des milliers de Salvadoriens en situation irrégulière et plusieurs centaines de Maras sont ainsi expulsés dans un pays exsangue, rongés par la pauvreté et le chômage, traumatisés par un conflit armé ayant pris fin quelques années auparavant après avoir fait plus de 100 000 morts. Ces Maras, important leurs structures criminelles au sein des banlieues-bidonvilles de San Salvador sont à l’origine de la Mara Salvatrucha et de la Mara 18, les deux principaux gangs locaux. Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes : ces 2 factions totaliseraient 15 000 membres répartis dans tout le pays (en 2005, entre le Salvador, le Guatemala et le Honduras, on dénombrait 70 000 membres de Maras); la douzaine d’homicides quotidiens (4000 morts par an en moyenne) sont imputés à 60 % aux Maras ; 70% des membres de ces gangs sont orphelins.
Ontologie de la violence
Voici donc le sujet du film de Christian Poveda ? Pas tout à fait. Car ici, le réalisateur s’est attaché à une histoire locale, délimitée entre deux ruelles du quartier de Soyapango – la Campanera et San Ramon –, où deux gangs ennemis se livrent une guerre sans merci. Caméra au poing, le réalisateur suit le noyau de la Mara 18, sorte de communauté de gamins englués dans cette vida loca, cette « vie folle », entre survie, exclusion, pauvreté crasse, abandon familial, répression, prison, ritualisée autour des enterrements qui ponctuent la narration.
Le film de Christian Poveda transcende la motivation journalistique, et la lecture politique ou sociologique pour envisager un niveau supérieur de la conscience. Certes, des réponses rationnelles, il y en a, et Christian Poveda les connaissait, et les illustrait depuis longtemps. On peut, à ce titre, regarder en bonus du DVD, l’entretien dans lequel il autopsie le crime de façon très claire. Il y rappelle les turpitudes d’un régime d’extrême droite laissant délibérément à l’abandon la population, et n’envisageant la violence sociale que pour l’utiliser dans un discours sécuritaire et électoral. Certes, la férocité nord-américaine, terreau privilégié de la graine de violence, ses importations évangélistes en terre sainte d’Amérique Centrale, la mondialisation, le choix de la répression plutôt qu’une vraie politique sociale, sont autant de réponses aux multiples « pourquoi » qui taraudent sans cesse à la vision de ces brutales 90 minutes.
Et pourtant, ici, pas de rappel historique, pas d’interviews de politiciens ou de spécialistes, ni de chiffres, de descriptifs de trafics de drogue, rackets, cambriolages, proxénétisme et autres menus fretins. Pas de rôles précis, d’explications sur les structures hiérarchiques du gang. À travers la vie de Wizard, Chucky, Spider, El Moreno et leurs compagnons d’infortune, Christian Poveda met en scène une métaphysique du mal, une ontologie de la violence, émergeant telle une mécanique sans fondement, une machine folle.
On dit de cet homme, et cela est sans doute vrai, qu’il était avant tout un humaniste. On apprend par exemple dans le reportage d’« Envoyé Spécial » qui lui est consacré (voir le bonus) qu’il a lui-même pris part au projet de boulangerie, structure associative de réinsertion qu’il suit dans son documentaire. Des contrepoints rythment le film : l’un sonore, des coups de feu qui préludent aux visions de cadavres étendus. L’autre visuel, les mains roulant des petits pains dans une dynamique d’espoir… Et pourtant, ce film a un sérieux goût de désespoir et de fatalité. Car les bras vous en tombent au rythme des morts qui jonchent le film, et il n’y pas toujours de réponse au pourquoi. Un destin implacable fait de ces mioches de la chair à prison, et des clients de la morgue. La révolte nihiliste des protagonistes est comme l’illustration d’un Mal absolu.Rien ne sauve rien. Sauf un médecin peut-être qui fait à la fois peu et beaucoup, en essayant modestement de trouver la prothèse qui redonnera le sourire à une jeune femme éborgnée. Des efforts inutiles, des paroles inutiles, perdus dans un monde dantesque. La violence se distille partout, jusque dans les oraisons funèbres des compagnons assassinés par le gang rival : « D’autres mourront, la 18 vivra toujours ! » Dès lors, on peut toujours être touché par les histoires personnelles de Wizzard, ou de Spider, ou de Little One… Mais il ou elle ne sont plus que les pantins du Mal. Une des jeunes Maras se retrouve à l’hôpital après avoir miraculeusement échappé à la mort lors d’une fusillade. Elle apprend que son homme n’a pas eu cette chance. Telle une héroïne de Mérimée, ses larmes rageuses sont fertiles d’une violence encore une fois triomphante, condamnant la prochaine victime. De l’autre côté, une juge persiste, semble-t-il sincèrement, à renvoyer, menottes aux poignets, un adolescent en centre de redressement. Un officier de police parle dans le vide à des criminels incarcérés, leur proposant de « discuter ». Tout est inutile. Et même cette boulangerie, entreprise de réinsertion dont le gérant sera lui-même condamné pour assassinat. Face à ceux qui voudraient vraiment s’en sortir, la police veille au grain, l’arrêtant sur le chemin du travail. Dénoncé par ses tatouages, il est de toute façon coupable. Tout est inutile et la parole est vaine.
Los Olvidados
Des gamins des rues, une jeune femme éborgnée au sourire de Madone, un gangster de 25 ans grassouillet et bravache, un adolescent en centre de redressement… On pense inévitablement à Buñuel et à son film tourné au Mexique, Los Olvidados (« Les Oubliés », 1950), où des jeunes de la banlieue de Mexico ingurgitent puis délivrent en retour le seul langage qu’ils connaissent, celui d’une brutalité quotidienne tarissant toute illusion de rédemption. Le manque d’amour maternel en est la source. Dans le film de Poveda, une mioche de 18 ans au regard de tueuse encadré de tics nerveux, mère de deux enfants, cherche, avec une rancœur tenace et touchante, à retrouver sa mère qui l’a abandonnée à la naissance. Elle est le fil illustrant la misère affective et le besoin de trouver dans le gang une famille de substitution. Et parfois, ils pleurent. Surtout les femmes dans les lamentations déchirées, agrippées aux cercueils de leurs hommes. Mais à quoi bon, puisque l’oraison funèbre n’est que vengeance, que même lorsque le cadavre est une femme, on parle du camarade masculin qui ne reviendra plus. La caméra de Christian Poveda à ce titre n’est pas complaisante, et l’on a parfois du mal à ressentir de la pitié pour ces hommes et ces femmes qui s’aiment à la mode machiste made in Amérique centrale, viscérale mais souvent empreinte de violence, de termes orduriers, de sexualité agressive. Pas de complaisance non plus envers les faits de guerre racontés par El Moreno, balai en main. Le paumé distille dans un phrasé chuintant, mêlé au débit de la défonce, comment ceux du gang ennemi n’ont pas osé tiré parce qu’ils n’avaient pas les couilles. Quant à son anniversaire, un strip-tease cheap donne le ton. C’est sûr, ils ne sont pas ragoûtants. On est bien loin d’une série de clichés de tatouages Maras pour une galerie branchée. Tant mieux. Car Christian Poveda en suivant le fil du Mal, imprime une esthétique de la mort, sans effets, sans filtre, sous une lumière crue. Les imposants tatouages sont bien plus que le signe de l’affiliation au gang, un vêtement auquel on finit par s’habituer comme un linceul qui colle à la peau. Et les cercueils sont de macabres bonbonnières avec leur découpe en verre transparent pour exposer aux vivants le visage de la mort, enrobée de taffetas couleur chantilly.
Dieu est mort
Le plus absurde et révoltant dans tout cela, le grand paradoxe c’est Dieu. Dieu est partout, omniprésent dans toutes les bouches, en veux-tu en voilà. Dieu par ici, Dieu par là. Et Dieu toujours absent. Les meurtres se succèdent, les funérailles suivent. Un pasteur du Seigneur ne cesse de parler, un peu mollement, comme s’il n’y croyait plus lui-même, de la persistance du Mal et de ce Dieu qu’il invite à suivre malgré tout. Dialogue de sourds. L’oraison termine dans la haine sourde, les membres de la Mara 18, écartant les doigts en signe de ralliement. Cabalistique. L’officier de police prétend vouloir engager la discussion ? Oui mais, avec « l’aide de Dieu ». Pas de discussion possible. Une litanie quotidienne se dessine autour d’un Dieu sans cesse invoqué mais qui ne répond jamais : travail de réinsertion, fabrication de petits pains que le Christ oublie de multiplier, allaitement de l’enfant par une mère en partance pour la prison, funérailles et visites de la prison par le pasteur qui ne croît décidément plus à ce qu’il dit. Bon, reste le Dieu des Américains. Mais on sait bien que celui-là n’existe pas, qu’il n’est qu’un pur produit. Il est vendu ici par des évangélistes en short de boy-scouts à des mineurs du centre de redressement qui, une fois baptisés, sont sommés de continuer à suivre le Seigneur après qu’ils seront retournés dans la merde, à leur vie folle. Le sympathique pasteur salvadorien se lamente : « Tu comprends, les jeunes acceptent le Christ ici et une fois revenus chez eux, ça recommence, la drogue, le crime… ». Le jeune Spider, fraîchement baptisé dans une piscine en plastique, lui répond : « La religion, c’est déjà pas facile ici, alors là-bas ». Et puis surtout : « on n’est pas parfaits. On peut trébucher ». Une parole que le Christ aurait, lui, entendu. Son disciple Pierre n’a-t-il pas trébuché par trois fois avant de devenir le patron du Paradis… Mais on ne prête qu’aux riches et puisque Dieu est mort.
La mort de Christian Poveda
Parmi les bonus du DVD, un reportage de Frédéric Faux et Steeve Baumann, diffusé sur France 2 et intitulé « Le carnet de route : Christian Poveda, le chemin de la vérité », avance un scénario probable de l’assassinat. Un policier véreux aurait fait croire que le journaliste était une balance, déclenchant inévitablement un contrat sur sa tête. La raison de cette machination ? Une nouvelle faction de la 18 qui souhaitait prendre le pouvoir. Depuis, 32 suspects ont été arrêtés, tous membres de la Mara 18. D’autres éléments ont-ils été fatals au réalisateur ? Avant sa mort, son film a été diffusé sur Canal+Espagne. Des copies à 1 dollar pièce se sont rapidement retrouvées sur le marché noir au Salvador, où le film ne devait pas sortir afin de protéger les protagonistes. Il semble également que des membres du gang aient alors accusé Christian Poveda de faire du business sur leur dos. Quoi qu’il en soit il était conscient de la gravité de l’affaire. Les revendeurs ont d’abord été forcés de verser une rente sur chaque vente, faisant passer le prix de 1 à 5 dollars. Puis le réalisateur aurait tenté d’arranger les choses avec certains membres. Mais après avoir regardé le film de Christian Poveda, on se pose autrement la question de sa mort. Non parce qu’on y a trouvé d’autres pistes, mais plutôt parce qu’il pourrait bien n’y avoir aucune raison, à l’image de cette violence rebelle à toute tentative d’entendement. Christian Poveda le sentait-il ? Dans l’entretien qu’il donne (autre bonus du DVD), il explique comment, pour faire ce film, il a contacté les chefs, pour les convaincre d’accepter son projet. Le regard est doux, franc, bienveillant. Tout comme celui qu’il porte sur ces damnés de la vie, les filmant avec respect, tendresse mais sans concession, et sans jamais se mettre en avant. Joseph Kessel l’a écrit : on ne peut pas être ami avec un lion. Il finira inévitablement par vous dévorer. Poveda le savait-il lorsqu’il s’est mis dans la gueule du lion ? Un film comme un testament.
« La Vida Loca », DVD, bonus exceptionnels (Bac Vidéo).
Valérie Labrousse (grand reporter)
Invitée spéciale de la sandrinemarietteFactory
Mots-clefs :Christian Poveda